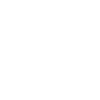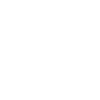Reverra-t-on un jour fleurir des industries sur notre sol après une période de désindustrialisation longue de plusieurs décennies ? Et à quelles conditions pour les industriels et les consommateurs ?
C’était l’enjeu de la rencontre « Relocaliser et réindustrialiser en Occitanie », qui s’est tenue le mardi 6 octobre à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain. Le potentiel est là, les acteurs semblent motivés : il n’y a “plus qu’à” !
« Avant, on produisait et on vendait. Maintenant, on regarde le marché et on essaie de produire en fonction du marché, en s’adaptant au plus près de la demande du client », écrivait le sociologue et historien Jean-Pierre le Goff, dans son ouvrage Le mythe de l’entreprise, en 1992. La baisse des coûts du transport et l’ouverture des marchés à l’économie mondiale a en effet contribué à la mutation de l’appareil productif français pour l’adapter au marché mondial. L’accélération des échanges et la baisse des barrières douanières ont été synonymes d’opportunités pour les entreprises et les consommateurs occidentaux : quand les premières ont pu baisser leurs coûts en délocalisant leur production dans des contrées où la main-d’œuvre était moins onéreuse, les seconds ont bénéficié de produits manufacturés plus abordables. Mais ce (faux) cercle vertueux, c’était “avant”.
VOIR LE REPLAY DE LA LONGUE-VUE
Des secteurs trop dépendants
Car, revers de la médaille, la mondialisation a aussi fragilisé la chaîne d’approvisionnement de ces mêmes entreprises. Une fragilité rendue évidente lors de la crise sanitaire du coronavirus, lorsque la filière électronique française a arrêté sa production pour cause de rupture d’approvisionnement des composants en provenance de Chine. « En fragmentant la chaîne de valeur, nous nous sommes rendus dépendants de chaînes qu’on ne maîtrise plus », résume Olivier Lluansi, ancien délégué en charge du programme « Territoires d’industrie », sous l’égide des ministères de la Cohésion des territoires et de l’économie, et maintenant associé chez PwC, en charge du secteur industriel.
En braquant les projecteurs sur ces risques, la crise sanitaire a révélé la fragilité et la dépendance du tissu industriel français, dont la capacité de produire des biens de consommation essentiels à l’économie et aux populations s’est révélée insuffisante au plus fort du confinement. Ainsi, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a lancé en août dernier, un appel à projets de (re)localisation. Au total, à ce jour 394 projets, représentant 372 millions d’euros d’aides et 1,5 milliard d’investissements industriels, ont été retenus et financés.
« On est aujourd’hui face à des acheteurs qui se sont fait peur pendant la crise, et qui aimeraient retrouver de la sérénité »
Olivier Lluansi
Le mot est lâché : après l’ère des « délocalisations », le monde de l’après Covid, marqué par la conscience de nos fragilités, sera-t-il celui de la relocalisation ? « Il ne faut pas faire d’angélisme sur ce sujet : travailler à la relocalisation, ça ne veut pas dire que, dès demain, il y aura des usines qui vont venir s’installer dans la région », prévient Marie-Thérèse Mercier, conseillère de la région Occitanie, membre de la commission industries, grands groupes et services aux entreprises, en introduction des débats.
Pas d’angélisme, donc, mais un espoir : celui de réduire les risques liés à la rupture de la chaîne logistique en rapprochant les fournisseurs des clients. « Le virus va-t-il faire naître de nouvelles usines ? », s’interroge Philippe Mabille, directeur du quotidien économique La Tribune, venu animer cette journée d’échanges. Possible, veut croire Olivier Lluansi. Et ce dernier de convoquer plusieurs études réalisées avant la crise sanitaire pour le ministère de la Cohésion des territoires : relocaliser ne serait-ce que 20 % des importations des PMI hexagonales représenterait un « potentiel de 65 000 emplois ». Quant aux grands groupes, ce sont 115 milliards d’euros d’importations qui pourraient être relocalisés pour réduire les risques liés à une crise globale. « On est aujourd’hui face à des acheteurs qui se sont fait peur pendant la crise, et qui aimeraient retrouver de la sérénité », appuie Olivier Lluansi.
La mondialisation, un Janus à deux visages
Comment en est-on arrivé là ? Comment se fait-il que notre pays ne produise quasiment plus rien de ce qu’il consomme ? « Nous avons vécu une désindustrialisation massive à partir du premier choc pétrolier, poursuit Olivier Lluansi. En 1975, l’industrie pesait quasiment 30 % du PIB français ; aujourd’hui, c’est à peine plus de 10 %. C’est une baisse qui a été aussi rapide que pour l’agriculture pendant l’exode rural, vingt ans auparavant. » Ce constat est connu. La triste litanie des plans sociaux en France, de la fermeture d’Usinor à Thionville en 1977 à celle de Moulinex en 2001, en passant par la fin des chantiers navals de Dunkerque est là pour le rappeler. « On a longtemps pensé que cette baisse était inéluctable. Or, c’est faux. Dès 1990, l’Allemagne n’a plus perdu d’industrie. 1990 correspond à l’accélération de la mondialisation. Et, la mondialisation est comme Janus : à deux visages. L’un maléfique, l’autre bénéfique : on peut utiliser la mondialisation pour aller produire moins cher plus loin, ou bien considérer que la mondialisation est une opportunité pour conquérir de nouveaux marchés. La France a suivi la première voie, l’Allemagne, la seconde », explique-t-il.
Gabriel Colletis, professeur agrégé d’économie à l’université Toulouse 1, pointe du doigt un autre facteur pour expliquer la désindustrialisation à la française : « Le passage de l’agriculture à l’industrie, puis de l’industrie aux services, a toujours été perçu comme un gage de modernité. Comme si un pays qui se modernise devait abandonner son industrie. Or, cette représentation des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, que l’on a tous apprise à l’école et que l’on doit à l’économiste Colin Clark, apparaît aujourd’hui dépassée, et porte grand tort à l’industrie, qui n’apparaît pas comme un secteur du futur, alors qu’elle doit être justement à la pointe pour relever les défis de la transition écologique ».

Quelles conséquences pour les territoires français ? Alors que ce sont les villages qui se sont dépeuplés lors de l’exode rural, la désindustrialisation a vidé les villes moyennes. « Ce sont elles qui étaient parvenues à attirer les industries, décrypte Olivier Lluansi : elles disposaient de main d’œuvre et offraient un foncier moins onéreux comparé à celui des métropoles ». Le mouvement des gilets jaunes, qui a secoué la France à partir de l’automne 2018 serait le dernier avatar, selon lui, de ce mouvement de fond de dépeuplement des villes moyennes. S’il faut « considérer les gilets jaunes comme un avertissement », appuie Thierry Ravot, directeur régional pour la région Occitanie à la Banque des territoires, « il y a urgence à réindustrialiser les territoires, abonde Olivier Lluansi. Si on ne le fait pas, ces villes moyennes, qui représentent 25 % de la population, vont rester en souffrance et poseront à terme un risque de cohésion pour notre pays ». Soit, mais comment ?
« J’en ai assez que l’on soit dans la transition depuis dix ans. A force d’être perpétuellement en transition, d’abord économique, puis écologique, j’ai l’impression que nous nous trouvons dans un espace-temps qui n’existe pas », appuie de son côté le représentant de la Banque des territoires. Pour lui, la solution réside dans le plan de relance : « Pas un sprint, mais le départ d’un marathon », qui permettra d’investir pour le long terme.
Des raisons d’espérer
Investir, donc. Les pouvoirs publics ont apparemment entendu le message, et font un effort pour « territorialiser » le plan de relance. Le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, a d’ailleurs été auditionné par la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée Nationale sur le sujet le 24 septembre 2020, promettant des « appels à projets déconcentrés » au plus proche de la réalité économique locale. Mais comment faire en sorte que les entreprises retrouvent des marges en produisant du Made in France ? Et, d’abord, est-ce vraiment possible ? « Soyons réalistes : nous allons rester dans un monde mondialisé, intense par ses échanges, prévient Olivier Lluansi. Mais pour sécuriser nos chaînes d’approvisionnement, il faudrait relocaliser 10 % de nos importations. Ça peut paraître beaucoup, mais ce n’est pas tant que ça ». L’évolution récente suivie par l’industrie lui semble positive : « Un ensemble de facteurs concourent à une relocalisation industrielle, une tendance très lente constatée pendant la décennie 2010 ».
« L’industrie a besoin de se verdir, elle peut jouer sa partie pour l’environnement, il n’y a plus d’opposition systématique entre industrie et environnement, comme c’était le cas auparavant »
Olivier Lluansi
La digitalisation, d’abord, qui permet de gagner en productivité, et donc de réduire la part d’emploi nécessaire à la production industrielle. La protection de l’environnement, ensuite : « L’industrie a besoin de se verdir, elle peut jouer sa partie pour l’environnement, il n’y a plus d’opposition systématique entre industrie et environnement, comme c’était le cas auparavant ». En s’affirmant comme une alliée de la lutte contre le réchauffement climatique, l’industrie favoriserait son acception par la population et donc sa proximité avec les zones habitées. L’hybridation produit-services, de même, qui permet aux entreprises d’augmenter leur valeur ajoutée par les services mis en place autour des produits plutôt que sur les produits seulement : « Comment comprendre ce que souhaitent les consommateurs français, par exemple en termes de location de trottinettes, lorsqu’on est basé en Chine ? », s’interroge Olivier Lluansi. Le besoin de disponibilité immédiate pour les consommateurs, enfin, pourrait être un atout qui plaiderait pour la relocalisation industrielle au plus près de leurs marchés.
Ramener pas-à-pas la production en France, c’est précisément ce qu’ont fait les entrepreneurs venus témoigner, ce mardi 6 octobre, à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain. Amixys est une entreprise d’une quarantaine de collaborateurs de l’agglomération montpelliéraine, qui conçoit et fabrique des robots aspirateurs depuis 2009. Son dirigeant et fondateur, Sébastien Roelens, assume avoir tiré parti de la possibilité de produire moins cher à l’autre bout du monde : « On est l’archétype de l’entreprise qui a tiré profit de la mondialisation. On est une marque revendeur, présente uniquement en ligne, sourcée à 100 % en Asie ». Une situation qui n’est pas aujourd’hui pour lui une satisfaction. « Nous sommes face à un constat : on a la maîtrise de l’innovation, mais nous n’avons pas le contrôle de la chaîne de valeur. »

Dépendre d’un fournisseur qui traite également avec vos concurrents implique un risque que les industriels doivent gérer et, si possible, réduire. Dominique Seau, président du groupe Eminence, une entreprise de fabrication de sous-vêtements qui n’a pas délocalisé sa production, revient sur les raisons de ce choix qui (d)étonne : « Mes prédécesseurs ont choisi de conserver un outil de production dans le Gard. Pourquoi ? Parce qu’ils considéraient qu’il était impossible d’innover si l’on avait affaire à des sous-traitants qui travaillent avec vos concurrents. Le risque de vol de technologie est trop important. »
L’espionnage n’est, en outre, pas le seul risque que fait peser la sous-traitance à l’international : « Ça coûte quatre fois plus cher de fabriquer un slip dans le Gard plutôt qu’en Asie, mais je préfère payer mes employés plutôt que des infrastructures de stockage », martèle Dominique Seau. Les coûts de stockage s’expliquent par la logistique : plusieurs semaines sont nécessaires pour être approvisionné par des fournisseurs du Maghreb ; depuis l’Asie, c’est en mois que ce délai se compte. « Risque pays, risque transport, risque lié à la situation monopolistique de son fournisseur… Le coût global d’un vêtement est élevé, et pas toujours bien évalué par les entreprises », considère le chef d’entreprise.
« Nous maîtrisons la technologie, mais nous avons perdu en Europe le sens de la production de masse »
Sébastien Roelens
Sébastien Roelens affirme pouvoir sortir, en janvier 2021, un produit dont 25 % de la valeur ajoutée sera produite à Lavérune, à moins de 10 km de Montpellier : « Nous procéderons à l’assemblage localement, et nous comptons remplacer le plastique par du bois, dans l’objectif de faire baisser le bilan carbone de nos produits, pièce par pièce ». Pourquoi ne pas produire l’intégralité des robots domestiques sur place ? « Nous maîtrisons la technologie, mais nous avons perdu en Europe le sens de la production de masse. On ne suit pas l’Asie sur les volumes de production », plaide le dirigeant, qui constate l’ironie à procéder à l’assemblage de produits fabriqués ailleurs, « exactement le même chemin qu’a pris la Chine il y a trente ans ».
Loin des aspirateurs, la Société coopérative d’intérêt collectif dirigée par Rémi Roux distribue des produits alimentaire éthiques : « Notre société coopérative ‘Ethiquable’, qui appartient à ses salariés, vend des produits biologiques et issus du commerce équitable depuis 17 ans. On est une marque transversale, c’est-à-dire qu’on vend différents produits pourvu qu’ils répondent à notre cahier des charges. » La Scop ne pouvait pas investir dans la douzaine d’usines différentes nécessaires à la production de l’ensemble des produits commercialisés sous l’étiquette Ethiquable, mais a décidé de se concentrer sur son produit phare : le chocolat. « Jusqu’à présent, les graines de cacao que nous achetions étaient torréfiées en Italie. Nous avons souhaité intégrer le chaînon manquant de la fabrication et nous avons donc construit une chocolaterie à Fleurance (Gers) ». Le groupe a investi quinze millions d’euros pour l’édification de cette unité de production, accompagnée par la région Occitanie et par la Banque publique d’investissements, pour relocaliser, au moins en partie, un produit agroalimentaire issu du commerce mondialisé. Un exemple qui illustre l’importance de l’aide publique dans les décisions de relocalisation. « On n’aura jamais le modèle économique des Vietnamiens ou des Chinois, mais l’intervention publique depuis dix ans, avec le CICE et le CIR, a pu encourager la tendance à relocaliser. Je ne pense pas que l’on puisse relocaliser toute la production automobile, mais il est possible de cibler les pièces à haute valeur ajoutée pour relocaliser sans perte de compétitivité », résume Olivier Lluansi.

Un avis partagé par Luc Mas, directeur général de Cameron France SAS, filiale du groupe Schlumberger, le géant spécialiste du forage pétrolier, qui, sans le Crédit impôt recherche, n’aurait pu faire évoluer son unité de production située à Béziers. Après avoir frôlé une fermeture au début des années 2000, le site s’est modernisé pour produire rapidement des pièces de forage à haute valeur ajoutée, et notamment les « risers », ces cordons ombilicaux des plates-formes pétrolières qui les raccordent au fond de la mer. Pour lui, c’est la recherche et la haute technologie qui permet à la France de rester compétitive «
Le Crédit impôt recherche nous a permis de faire évoluer les produits, ce qui nous a permis de rayonner. On a arrêté de se battre pour produire ce qui n’a pas de valeur ajoutée, parce qu’on ne sera pas compétitif. Pour nous, la recherche est le meilleur moyen d’exporter le made in France, et c’est ce qu’on a réussi à faire au sein de notre groupe : exporter la compétence des ingénieurs français. » La filiale biterroise a monté un partenariat avec le Commissariat à l’Energie Atomique pour monter une ligne pilote destinée à fabriquer des électrolyseurs, des petites unités capables de produire de l’hydrogène, en pariant sur le développement de l’énergie fondée sur cette technologie. Le dirigeant fonde beaucoup d’espoir sur l’investissement public. « On a réellement besoin du plan de relance pour développer l’énergie hydrogène, les risques liés au développement de ce nouveau produit sont très importants. Je sais que le public a la volonté de nous aider, mais il faut que les services adéquats s’alignent, pour que l’argent atteigne véritablement le territoire », prévient Luc Mas, interpellant Thierry Ravot, représentant de la banque des territoires.
Impossible consommateur !
S’il est possible, et souhaitable, de ramener la production plus près des consommateurs, comment, concrètement, favoriser ou encourager cette tendance ? « On ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. Vous ne le faites que si vos clients attendent que l’on produise en France, et les clients sont ambigus : ils veulent du Made in France, mais ne sont pas prêts à payer davantage pour l’obtenir », explique-t-il encore. « La question des consommateurs et de ce qu’ils achètent est à la fois un problème et une solution », tempère Cédrine Joly, de Montpellier Business School. « Le consommateur n’achète pas seulement un produit, mais toute la symbolique qui y est attachée », poursuit l’enseignante, qui a notamment travaillé sur la question des magasins de producteurs : « Les circuits courts permettent au consommateur d’acheter une forme de confiance et de recréer un lien avec le producteur. Une confiance que permet également la spatialisation de la production », dans un horizon visible, donc, par le consommateur. A l’évocation d’un système de bonus/malus en faveur du Made in France, Dominique Seau, le président d’Eminence, tique. « Il faut avoir conscience de ce que ça veut dire d’imposer des malus à des personnes captives des produits les moins chers : dans un contexte post gilets jaunes, le risque est énorme ».
Reste le puissant ressort de la commande publique pour favoriser la relocalisation de l’industrie. « Les collectivités et l’Etat achètent pour 300 milliards d’euros par an de matériels et de services. Si les règles européennes interdisent de demander explicitement du Made in France dans la commande publique, il est possible de jouer sur d’autres critères : la disponibilité du stock, ou la distance de la production à la consommation. C’est à notre portée », insiste Olivier Lluansi. Reste encore, selon lui, à porter une parole collective et unie sur l’industrie. Un discours en ligne avec celui de la cohésion territoriale : « La réindustrialisation est la clé pour résorber l’injustice territoriale ».
C’est dans ce cadre que la région Occitanie a lancé l’Agence Régionale des Investissements Stratégiques ainsi qu’un appel à projet « Rel’Occ », qui ont tous deux pour objectif d’encourager à la relocalisation/localisation d’activités industrielles dans 5 secteurs stratégiques pour l’Occitanie : la santé, l’agroalimentaire et l’alimentation, les mobilités – transports et logistique, les énergies renouvelables – la transition énergétique, le numérique.
Recevoir LEs prochaines actualités